Emma, entre stage et passion
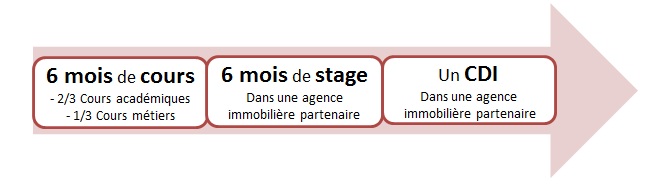
Je ne me souviens même pas du moment auquel je me suis rendue compte que j’aimais les chevaux. Il parait qu’à mes 3 ans j’essayais déjà de sauter du petit train de la Rhune à Biarritz pour rejoindre les poneys sauvages de la montagne (les Pottocks) et que ma tante devait me tenir par les pieds pour ne pas que je m’échappe.
Cet amour a grandi en même temps que moi. Il m’a appris à m’affirmer, puis à me canaliser, et enfin à clarifier mes intentions. Comme un chemin linéaire j’acquis mon premier poney à mes 12 ans, puis mon premier cheval à mes 18 ans. Je suis toujours partie du principe qu’ils étaient comme moi, qu’ils avaient besoin d’être libres et indépendants. J’ai donc décidé de les laisser à la campagne, à 1h30 de Paris en train.
Les années collège et lycée furent les plus dures pour moi, j’avais ce besoin et cette envie permanents d’aller voir mon poney mais je ne pouvais pas, école oblige. De plus, chaque aller-retour représentait une organisation titanesque puisque je n’étais pas véhiculée. Mais qu’importe, mon poney était heureux, des personnes de confiance s’en occupaient durant mon absence, et c’était tout ce qui importait.
L’école supérieure m’a permis de me rapprocher de ma passion. J’avais enfin le permis de conduire, mes amies avec qui je montais à cheval l’avaient aussi, et mes horaires étaient allégés, ce n’était donc pas très compliqué de rentrer, je suis alors tombée dans le piège de l’addiction. Il fallait absolument que je rentre voir mes poneys dès que j’avais 24 heures sans cours. Puis le covid est arrivé, avec celui-ci les cours en distanciel, le confinement, et toutes les conséquences que vous connaissez déjà. J’avais donc la chance de pouvoir voir mes poneys tous les jours puisqu’ils vivaient dans le jardin de ma maison. Au plus près de moi, je pouvais les voir dès que j’ouvrais mes fenêtres. Le piège s’est alors refermé, entre deux crises du Covid, je n’avais qu’un espoir : que les cours continuent en distanciel, et lorsqu’ils ont repris en présentiel, je m’arrangeais pour choisir les cours qui me permettaient de rester le plus longtemps possible près de mes chevaux.
Après la période de cours, vient toujours la période de stage, j’avais pu m’arranger pour les faire en télétravail en première et deuxième année. Mais pour la troisième année, il semblait plus sérieux de faire un stage en présentiel. C’est alors pleine d’appréhension que je me mis à chercher un stage. Après de nombreux déboires, je trouvai enfin un stage qui me correspondait. Mais à Paris, je devais donc faire une croix sur le fait de nourrir mes chevaux, de les soigner et de les sortir 4 à 5 fois par semaine.
Dès la première semaine, mon patron semblait plutôt ouvert au télétravail. Manque de chance, il nous accorda dès le début un jour de télétravail le jeudi. C’était déjà génial, mais je me voyais déjà faire des allers retours permanents et passer plus de temps en train et en voiture qu’avec mes chevaux.
Première semaine, j’arrive le vendredi avec une mine défaite, j’étais réveillée depuis 5 heures du matin pour nourrir mes chevaux avant de prendre mon train et arriver au travail. Je dois l’avouer, je n’avais même pas eu le temps d’essayer de cacher ma fatigue. Cet aller-retour m’avait réellement conforté dans l’envie de pouvoir négocier mon télétravail le lundi, le mercredi ou le vendredi pour ne pas avoir à faire l’aller-retour en 24 heures. Entre deux portes, je fais part à mon patron des raisons de ma fatigue en toute transparence, en espérant que mon histoire le touchera, et sans vouloir pour autant imposer quelque chose.
Vint alors le lundi, mon patron m’invite dans son bureau, le stress monte alors, je me demande si j’avais commis une erreur. Un sourire se dessina sur son visage. Il me confia qu’il avait vendu la mèche auprès des différents collaborateurs, et qu’ils étaient tous touchés par mon histoire. Il me dit aussi qu’en l’espace d’une semaine une confiance était déjà établie en terme de motivation et de dossiers rendus et ajouta « je ne veux plus vous voir aussi fatiguée que vendredi, on va s’arranger pour vous accorder plus de télétravail, deux jours par semaine me semble bien, donnez-moi les jours qui vous arrangent ». Il conclut en m’expliquant que ce genre d’adaptations était possible dans une TPE et pas dans un grand groupe, puisque dans le cas de la TPE chaque individu est connu de tous et on a le temps de faire du cas par cas. Je me rendais alors compte de la chance et de l’opportunité que j’avais. Après avoir vu toute la partie organisationnelle auprès des personnes qui prenaient soin de mes chevaux durant mon absence, je demandai le lundi et le vendredi qui me furent accordés.
Le résultat ne se fit pas attendre. Enfin j’étais heureuse de me rendre au travail, ce travail qui m’offrait tant, et qui me permettait de voir mes chevaux cinq fois par semaine. Enfin, j’avais l’impression de ne pas perdre mon temps dans un travail complètement opposé à ma raison de vivre, et dans lequel je ne pouvais même pas évoquer les deux êtres qui avaient façonné la personne que j’étais. Enfin, je pouvais entendre mes poneys s’exalter lorsqu’ils s’apercevaient que ma voiture arrivait près de leur pré. Enfin j’étais heureuse, vraiment et pleinement heureuse.
J’aurai, pour sûr, tiré un nouvel enseignement de cette période : il faut demander. Je n’aurai rien perdu si mon patron m’avait dit non, cela m’aurait déçu, certes, mais je l’aurai aussi été en ne demandant rien. Je pense aussi qu’il faut mériter ce qu’on nous accorde et ne pas trahir la confiance qui nous est donnée, et cet enseignement sera d’autant plus utile lorsque je rentrerai dans la vie active. J’ai aussi la preuve que ce fonctionnement peut marcher, ce qui me rassure pour mon avenir professionnel, mais qu’il faudra que je choisisse le genre d’entreprise dans lequel je travaillerai.
Enfin, le dernier enseignement sera clairement de toujours chercher à atteindre son équilibre. J’atteins le mien et je suis productive lorsque je suis heureuse, donc au contact régulier de mes chevaux, alors pourquoi s’en priver ?


